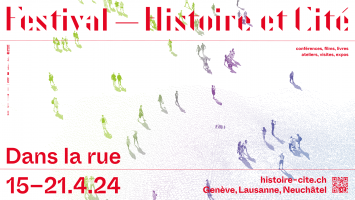News - Events
Latest news
A selection of recent relevant news
-
Published on
12th iGE3 Annual Meeting
Louis-Jeantet Foundation, Geneva - November 9, 2023 - Registration deadline: October 31, 2023

-
Published on
11th iGE3 PhD Awards - Call for application
For graduate students working in the laboratories of iGE3 members - Registration is closed

-
Published on
Scales or feathers? It all comes down to a few genes
Publication by Milinkovitch group

-
Published on
Gene responsible for severe facial defects identified
Publication by Antonarakis group

-
Published on
Bypassing antibiotic resistance with a combination of drugs
Publication by Kline group
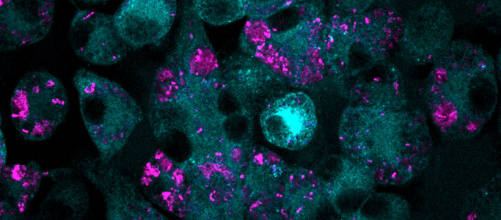
-
Published on
Prix 3R 2023
Un des Prix 3R 2023 récompense Vladimir Katanaev

-
Published on
Prix Leenaards 2023
Un des trois Prix Leenaards 2023 décerné à Camilla Bellone

-
Published on
iGE3 conference - Silvia Arber
Neuronal circuits for body movements

-
Published on
New iGE3 member - Sophie Martin

-
Published on
New iGE3 member - Christoph Scheiermann

-
Published on
11th iGE3 Annual Meeting
Louis-Jeantet Foundation, Geneva - Hybrid via Zoom

-
Published on
10th iGE3 PhD Awards - Final selection
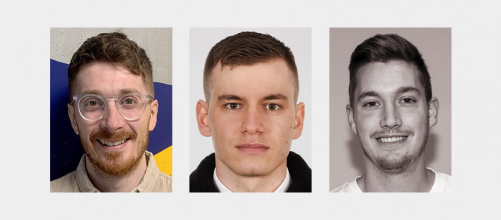
UNIGE Event Agenda
PerformanceExplorations urbaines par 4 collectifs interdiscipinaires
More information20.04.2024 13:00 – 17:00 / Rendez-vous aux fontaines des Tours de Carouge pour la restitution publique
Soirée étudianteUniart fait son live #9
More information20.04.2024 17:00 – 21.04.2024 01:00 / Floky la loutre, 44 rue de Carouge Genève, 1205
AnimationsFestival Histoire et Cité 2024
More information20.04.2024 12:00 – 21:00 / Uni Dufour / divers
PerformanceCarouge et le Monde: les hautes écoles EXPLOREnt l'(extra)ordinaire
More information19.04.2024 – 20.04.2024 / Tours de Carouge et Marbrerie 13
ExpositionÀ travers rues
More information15.04.2024 08:00 – 10.05.2024 17:00 / Uni Dufour, hall Rue du Général-Dufour 24, 1204 Genève
AnimationsHôpital des nounours 2024
More information15.04.2024 – 21.04.2024 / Salle communale du Faubourg, Rue des Terreaux-du-Temple 6, 1201 Genève